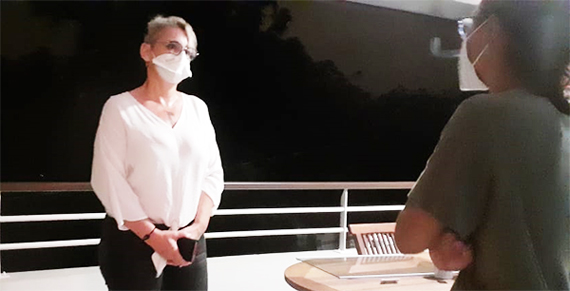A l’heure actuelle, la chirurgie esthétique devient de moins en moins taboue en France. Beaucoup de Français commencent alors à s’intéresser à la rhinoplastie. Il s’agit d’une technique qui vise à changer la taille ou la forme du nez. Cette intervention est avantageuse dans la mesure où elle améliore le bien-être psychologique ainsi que la santé. Néanmoins, cette chirurgie est également adoptée dans un souci d’être plus attrayant.
La rhinoplastie pour améliorer sa respiration
L’amélioration de la respiration peut être une raison valable pourfaire une rhinoplastie avec Medespoir. Effectivement, certaines personnes sont sujettes à des anomalies génétiques. Elles vivent leur vie de tous les jours sans s’en rendre compte, comme si ces gènes étaient normaux. Ces éléments d’excroissances peuvent pourtant entraver leur respiration notamment si les individus en question pratiquent du sport.
Afin de résoudre ce problème, de nombreux spécialistes en ORL préconisent une intervention que l’on connaît sous le nom de septoplastie. Cette dernière s’avère indispensable lorsque la cloison nasale n’est pas très droite ou qu’elle touche les os ainsi que le cartilage du nez. Contrairement à ce que l’on pense, ces déformations ne sont pas toujours dues à des traumatismes. Elles sont pour plupart des cas congénitaux.
Réalisée sous endoscopie, une telle opération dure en moyenne 1 heure. Le chirurgien introduit alors une mèche imbibée de xylocaïne naphazoline dans le nez en vue d’atteindre la surface cartilagineuse du septum nasal. Ce n’est qu’après qu’il procédera à l’ablation de la protubérance qui est à l’origine de la déviation. Un remodelage peut aussi être adopté en complément à cette chirurgie du nez.
L’hypertrophie des cornets peut également provoquer cette sensation de nez bouché. Ces cornets sont les petites ramifications responsables du réchauffement puis de l’humidification de l’air avant que celui-ci n’arrive aux poumons. Le traitement de cette maladie peut alors être effectué en parallèle à la septoplastie. Dans cette optique, l’intervenant aura à diminuer leur volume ce qui aura pour effet de faciliter la circulation de l’oxygène dans l’organisme.
Corriger ses défauts pour un bien-être psychologique
Pour la plupart des gens, c’est à l’adolescence que le nez commence à poser problème. Il est vrai que seuls peu de jeunes se trouvent véritablement beaux ou belles à cet âge. Cependant, à chaque fois qu’ils regardent le miroir le matin au réveil, leur nez est une des premières choses qu’ils voient. Un petit défaut peut alors tourner en vrai cauchemar voire en obsession chez certains.
Certes, la partie esthétique est importante dans une rhinoplastie. Toutefois, pour de nombreux patients, l’on cherchera surtout à se défaire d’un défaut en particulier. A ce titre, l’on peut citer le problème des narines trop larges ou encore une bosse nasale plus accentuée que la normale. La racine du nez peut aussi être mal vue, et ce, qu’elle soit creuse ou comblée. En ce qui concerne la pointe du nez, une personne peut trouver la sienne trop longue, trop tombante ou trop remontée.
En général, nul ne se soucie d’avoir le plus beau nez au monde. Toutefois, une personne ne sera satisfaite que si l’on corrige le problème qu’elle juge le plus remarquable. Il sera donc important pour un chirurgien plastique de bien se renseigner sur la motivation de celle-ci avant de procéder à l’opération. Cet aspect psychologique est susceptible de varier d’un sujet à un autre.
Se faire opérer pour des raisons esthétiques
Il arrive que la rhinoplastie ne résulte pas d’un problème vital et encore moins d’un complexe intérieur. Pour une poignée de gens, la chirurgie est une option leur permettant de ressembler plus à leur star favorite. Pour d’autres, cette intervention répond à un objectif ultime qui est de plaire au maximum de gens. Ces raisons, bien que superficielles, sont amplement suffisantes pour pousser une jeune fille ou un jeune garçon à faire le pas.
Pratiquer la rhinoplastie permet à une personne de retrouver un certain équilibre facial. Celle-ci souhaite effectivement que son nez s’intègre parfaitement aux traits de son visage et que celui-ci ne soit ni trop proéminent ni trop discret. Le but est donc qu’une chirurgie puisse créer cette harmonie que l’on recherche dans ce type d’opération.
En plus d’embellir, cette pratique a l’avantage de rajeunir le patient. En effet, le nez a tendance à tomber progressivement au fur et à mesure que l’on vieillit. Remonter sa pointe de nez et rectifier la petite bosse auront certainement un effet rafraîchissant. Néanmoins, les personnes qui le font sont de plus en plus rares.
Toujours dans un souci d’embellissement, beaucoup songent à changer la forme globale de leur nez. Or, il arrive que cela nécessite des modifications sur plusieurs points à savoir le dorsum, la forme des narines ou la pointe nasale. Un remodelage est même considéré comme étant un moyen de modifier son apparence tout en gardant son identité ethnique.
Que faut-il savoir avant de faire une chirurgie du nez?
De nombreuses raisons peuvent motiver une personne à réaliser une rhinoplastie. Toutefois, il est essentiel de noter quelques points avant d’oser. Bien que la douleur en elle-même ne soit pas aussi importante qu’avec une fracture, des complications peuvent survenir. C’est le cas notamment si l’intervention a été réalisée par un piètre chirurgien.
Quelles sont les complications possibles ?
A défaut d’antibiotiques, le nez peut par exemple faire l’objet d’une infection. Par ailleurs, il se peut que des hématomes surviennent après l’opération. Ces derniers s’accompagnent généralement d’une douleur atroce et d’un gonflement. Il sera alors nécessaire d’effectuer une deuxième opération en vue de les évacuer.
Et les suites post-opératoires ?
Avoir des ecchymotiques ou des paupières gonflées est normal suite à une rhinoplastie. Ces symptômes ne sont cependant que provisoires. Elles disparaissent au bout de deux semaines. Cela dit, des soins post-opératoires sont préconisés par les médecins. Le patient devra par exemple utiliser du sérum physiologique en gouttes pour assainir son nez. Ces suivis peuvent se faire jusqu’à un an. C’est pourquoi il est proscrit de se lancer dans une rhinoplastie sur un coup de tête.